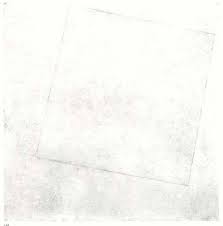Sous une forme ou une autre, c’est celle que l’on prononce systématiquement en entrant dans l’atelier. J’ai nommé : la petite phrase d’excuse. Caricaturalement, elle dit : « Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je ne suis pas vraiment créatif (ve).« 
Je l’appelle la « petite phrase d’excuse » parce qu’elle en a le ton mais ce qu’elle dit ressemble davantage à un déni de ses capacités. « Les autres savent, réussissent, méritent d’être là, de se dire créatifs, artistes, de s’exposer… moi, non. » Une comparaison dans l’absolu qui ne prend personne en particulier comme point de repaire, juste que les autres, oui, certainement, mais moi, non. Et n’allez pas croire qu’elle ne concerne que les débutants. Pas du tout. Elle prend juste des formes plus élaborées. Par exemple : « Je suis peintre mais je n’ai jamais appris, alors c’est peu un hasard si ce que je fais plait. » Ou encore « Je ne comprends pas pourquoi on m’achète mes tableaux. Ils ne sont jamais assez aboutis (finis, satisfaisants, professionnels, etc)« . De là à penser ceux qui les achètent sont, soit gentils, soit aveugles…
Mais d’où vient-elle, cette petite phrase?
Drôle de mélange, entre modestie et audace. Comme un rituel pour se garantir d’un jugement extérieur qui serait pire que le sien. Se dénigrer pour ne pas avoir à l’être par d’autres. Se différencier négativement pour être mieux pris en compte, respecté, entendu. Un drôle de truc compliqué et bizarre qui nous traverse tous la tête, débutants ou confirmés. Un reste d’on ne sait quoi, qui vient polluer le droit, légitime, simple, évident d’être là parce qu’on a fait le chemin pour y être.
 Ça se joue à plusieurs niveaux. J’y entends tout d’abord une empreinte plus ou moins déguisée de notre bonne vieille éducation occidentale. Il faudrait être méritant pour mériter d’être. Comme il faudrait déjà savoir pour mériter d’apprendre. Et, sans doute, être peintre avant de l’être. Mais qui décide de la chose? Papa et maman? la maîtresse? Le grand frère? Le grand-père?
Ça se joue à plusieurs niveaux. J’y entends tout d’abord une empreinte plus ou moins déguisée de notre bonne vieille éducation occidentale. Il faudrait être méritant pour mériter d’être. Comme il faudrait déjà savoir pour mériter d’apprendre. Et, sans doute, être peintre avant de l’être. Mais qui décide de la chose? Papa et maman? la maîtresse? Le grand frère? Le grand-père?
Et pourquoi pas soi même? Hein? Enfin, quoi? Qui sait mieux que tout le monde ce qui nous attire, nous titille, nous travaille, se rappelle à nous comme une frustration ou une invitation? Hein? Qui donc, sinon nous-même? En quoi serait-il prétentieux de justement s’entendre, se répondre, essayer? Puisque ça insiste en dedans c’est bien qu’il doit déjà y en avoir un peu. Tout comme il y a dans une question déjà un peu de sa réponse, non?
« Mais, finissent par avouer certains, créer ça n’est tout de même pas sérieux… On ne peut pas en faire sa vie. On doit nourrir ses enfants, payer la maison, régler les traites… » Deuxième aspect donc de la fameuse petite phrase : j’aimerai bien, mais j’peux point. Et là, ça n’a rien de technique. L’impossibilité relève bien moins de mes limites que de ma survie. Laquelle survie exige des réponses sonnantes et trébuchantes : combien ça va me rapporter? Pour la faire vite : « Si je me mets à créer, à quel moment vais-je crever de faim? »
Je suis donc là, dans l’atelier MAIS je m’autorise une chose qui n’est pas autorisée : faire ce qui me démange. MAIS qui ne rapporte pas d’argent (ou alors, seulement quand on a du bol).
Créer, pour quoi faire alors?
Mon avis de coach, c’est que vous êtes là parce que vous en avez ENVIE. A entendre aussi EN-VIE. Et parce que vous êtes en vie, vous n’êtes pas des machines, aussi performantes puissent-elles être, mais des êtres humains à qui la vie a été accordée. Inutile donc de chercher à la gagner, cette vie : vous l’avez!
Que se joue t-il véritablement dans l’atelier? Que se cache t-il véritablement derrière la petite phrase d’excuse?
 Derrière se cache la moitié de nous. Pas tout de nous. Juste la moitié. Celle qui ne trouve pas sa place dans l’idée d’être performant, de gagner, de réussir, de payer les traites, de prendre rendez-vous chez le dentiste, de ne rien oublier d’important… Juste l’autre moitié de nous. Celle qui sent, ressent, est touchée, émue, bouleversée, retournée, chavirée, émerveillée, éblouie, ravie. Celle qui palpite, gargouille, se noue, se dénoue, bat la chamade… Sourit aussi. Celle que l’on ne lâche pas si facilement. Celle qui exige un lâcher-prise, d‘être lâchée pour être bien prise.
Derrière se cache la moitié de nous. Pas tout de nous. Juste la moitié. Celle qui ne trouve pas sa place dans l’idée d’être performant, de gagner, de réussir, de payer les traites, de prendre rendez-vous chez le dentiste, de ne rien oublier d’important… Juste l’autre moitié de nous. Celle qui sent, ressent, est touchée, émue, bouleversée, retournée, chavirée, émerveillée, éblouie, ravie. Celle qui palpite, gargouille, se noue, se dénoue, bat la chamade… Sourit aussi. Celle que l’on ne lâche pas si facilement. Celle qui exige un lâcher-prise, d‘être lâchée pour être bien prise.
Pour moi, l’atelier fait partie de ces lieux indispensable à l’équilibre de l’humanité où cette fameuse moitié de nous trouve pleinement, légitimement, simplement, la place qui lui est due. Une place pour ne pas gagner sa vie mais la vivre. Il n’est pas le seul lieu de ce type mais il est celui que vous avez choisi. Lui, avec ses pinceaux, ses couleurs et ses odeurs…
Ne vous excusez donc pas de venir. Votre envie (en vie) est juste. Et je la prends avec vos doutes. Le tout décantera dans l’atelier.
Retour à la page d’accueil
 Je vous ai déjà parler longuement du blaireau, cette brosse timide et audacieuse dont il est facile de tomber amoureux. Mais la brosse qui parle le mieux du glacis est incontestablement le spalter à crans (ou spalter à dents selon que l’on ait envie de la voir mordre un peu la couche picturale ou non). Chaque brosse a sa personnalité. Celle du spalter à dents est dégourdie, débrouillarde et exigeante.
Je vous ai déjà parler longuement du blaireau, cette brosse timide et audacieuse dont il est facile de tomber amoureux. Mais la brosse qui parle le mieux du glacis est incontestablement le spalter à crans (ou spalter à dents selon que l’on ait envie de la voir mordre un peu la couche picturale ou non). Chaque brosse a sa personnalité. Celle du spalter à dents est dégourdie, débrouillarde et exigeante.