Créer, ça permet de…


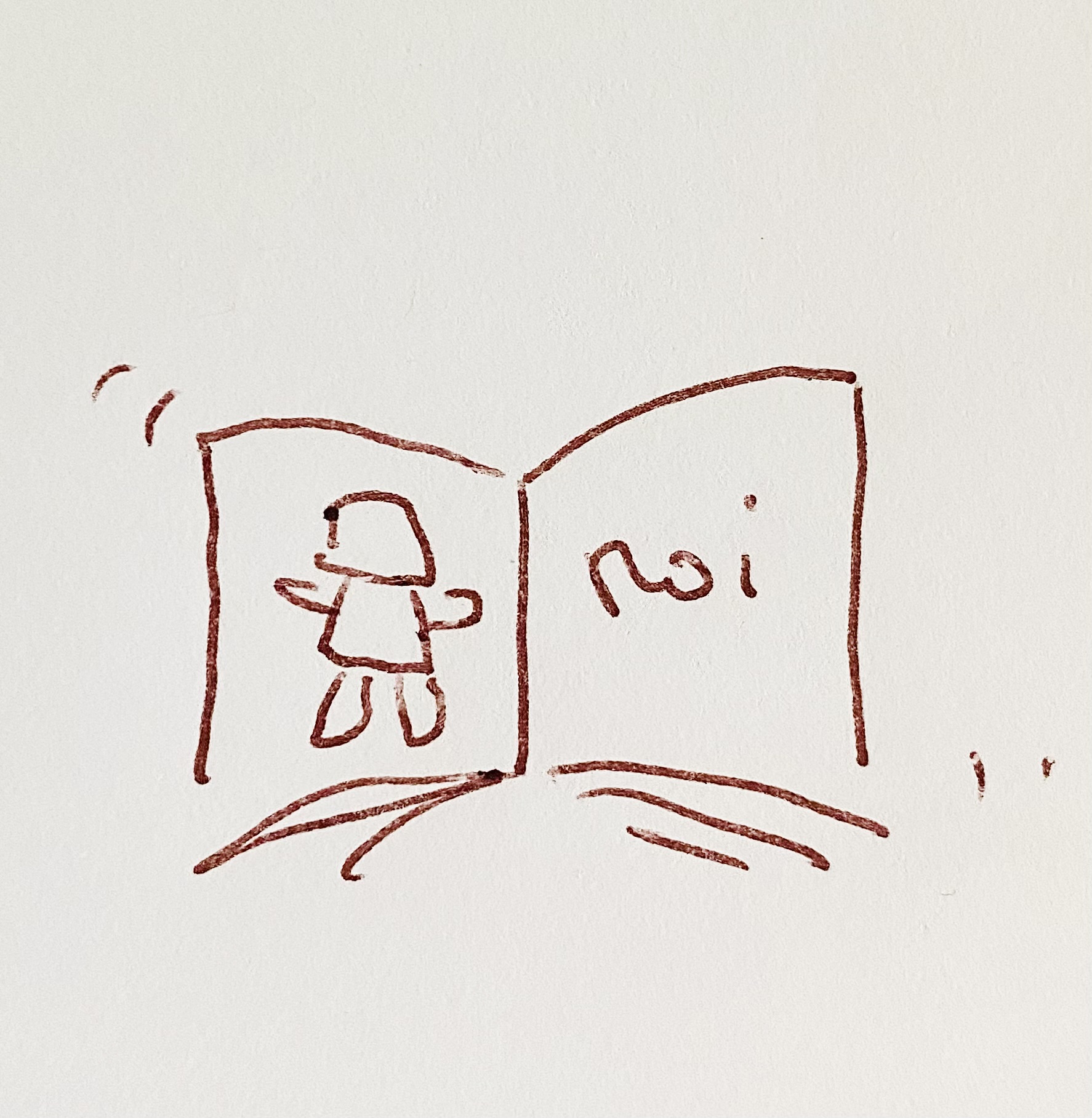
Mais c’est aussi un besoin essentiel
Aussi important qu’aimer, être en sécurité, être en lien. C’est l’une des fonctions essentielles de notre cerveau et ça va beaucoup plus loin que de faire du travail manuel…
Coach certifiée, consultante en entreprise, enseignante à l’université et peintre

Je vous accompagne, à Niort (79) et partout ailleurs en distanciel, pour créer votre vie et créer dans votre vie. Ensemble, nous élaborons votre Processus créatif personnel
Vous pouvez dors et déjà prendre contact avec moi en cliquant ici ou vous promener dans les onglets du menu en haut de page.
Votre « moi-artiste » vous donne rendez-vous et je suis là pour que vous ne le ratiez pas !
